C’est l’histoire d’une docteure en psychologie cognitive, passionnée de jeux vidéo (depuis Space Monster sur sa Vidéopac !) et de développement du cerveau des enfants, qui se retrouve de l’autre côté de l’Atlantique à travailler pour Ubisoft ou Epic Games. Rencontre avec Celia Hodent, aujourd’hui consultante en UX gaming et autrice du récent L’UX, c’est quoi exactement ? (Dunod), qui nous offre un éclairage passionnant sur la conception produit, par le prisme des processus mentaux.
8 minutes de lecture sans appuyer sur le champignon
📩 Article issu du Ticket n°046
Bonjour Celia. Afin que tout le monde parte avec un socle de connaissances minimum sur le sujet, est-ce que tu pourrais rappeler quelques principes de base des sciences cognitives pour des Product Managers ?
Celia Hodent : Je pense que l’élément principal à savoir, c’est que notre cerveau, nos processus mentaux pour être précis, ont des limites cognitives. Cela vaut pour nous en tant que concepteurs mais aussi pour les utilisateurs de nos produits. Il y en a trois majeures :
➀ La perception est subjective
On ne perçoit pas le monde tel qu’il est réellement. C’est une construction de notre cerveau. Ce n’est pas parce qu’une icône est évidente pour toi qu’elle l’est pour tout le monde.
➁ La mémoire est faillible
La mémoire est, elle aussi, une reconstruction de notre cerveau. Elle ne va pas nous permettre de nous rappeler de tout ce que l’on a vraiment vécu par le passé.
➂ L’attention est volatile
Enfin, l’attention fonctionne comme un filtre. Quand on se concentre sur une chose, notre cerveau va filtrer tout le reste. C’est pourquoi il faut toujours avoir en tête que les utilisateurs vont se focaliser sur un ou deux éléments dans son produit et que s’il y a trop d’informations ou d’actions à faire, ils vont être perdus.

Tu peux nous expliquer comment tu utilises concrètement ton expertise en sciences cognitives pour améliorer l’expérience d’un jeu vidéo ?
Celia Hodent : Cela passe en premier lieu par la phase de tutoriel, autrement dit l’onboarding. Le but : accompagner les joueurs pour leur apprendre le fonctionnement du jeu, sans qu’ils et elles aient à se rendre sur Internet ou à lire un manuel. Tutoriel ne signifie d’ailleurs pas forcément un long texte qui coupe l’expérience, au contraire.
Prenons un exemple qui va parler à tout le monde : Mario. Au niveau 1, le personnage est tout à gauche. C’est une façon de dire au joueur qu’il doit avancer vers la droite. Ensuite, il y a un ennemi qui arrive. Il faut sauter pour l’éviter et, justement à ce moment, il y a une brique au-dessus sur laquelle on va taper pour gagner un bonus (le fameux champignon).
Tout est fait de manière subtile pour guider les joueurs sans qu’ils aient l’impression qu’ils sont en train d’apprendre le jeu. L’important, c’est leur perception. C’est ce que l’on appelle le level design, une façon de réfléchir à l’architecture d’un niveau, notamment pour accompagner au mieux les joueurs.
C’est une manière de faire en sorte, via l’UX, de favoriser leur rétention également…
C.H. : Oui. Car il faut bien voir que notre attention est limitée… mais notre patience aussi ! Si une personne ne comprend pas d’emblée comment jouer, elle ne va pas se dire “Je vais regarder plus attentivement”. Non, elle va se dire “C’est buggé, je vais aller voir ailleurs”. Les gens n’en ont rien à faire, en soi, de notre produit.
D’où l’intérêt des boutons d’appel à l’action (les CTA) bien visibles. C’est en effet notre rôle de diriger l’attention des utilisateurs vers ce qui est le plus important pour eux. On le voit par exemple dans le travail de priorisation des sons dans un jeu vidéo.
C’est-à-dire ?
C.H. : Si je prends l’exemple d’un jeu de combat, on prend l’hypothèse que le plus important pour un joueur, c’est son état de santé personnel. Il va donc y avoir une hiérarchisation des sons pour refléter cette priorisation.
Le son de quelqu’un qui vous lance une grenade en pleine tronche aura un niveau de prio qu’on appelle P0. Cela va être la priorité des joueurs. Par contre, deux personnages en train de discuter en arrière plan seront, disons, des P3. Ainsi, compte tenu de nos limites attentionnelles, le système va faire en sorte que quand plusieurs sons peuvent être joués en simultané, le P0 sera toujours prioritaire sur le P3 qui sera soit atténué soit carrément pas joué.
Tu parles d’aider les utilisateurs… Mais il est aussi possible de jouer sur ces mêmes biais pour leur faire faire des actions qui favorisent son business, ce qu’on appelle les Dark Pattern. Peux-tu nous dire pourquoi tu considères qu’il s’agit de l’antithèse d’une démarche UX ?
C.H. : Oui, on peut penser aux fenêtres de collecte des cookies par exemple : il est plus facile de les accepter que de chercher comment les refuser.
L’UX est en effet très mal comprise. L’approche UX, cela veut dire comprendre les limites de l’humain (physiques et mentales) afin d’améliorer la vie des gens par un produit ou un objet. La logique est bienveillante. C’est du gagnant-gagnant, car si les utilisateurs sont contents, tu devrais normalement réussir à atteindre tes critères business derrière.
Les dark pattern, c’est exploiter les biais des êtres humains pour optimiser les revenus de son entreprise, sans se soucier de la volonté des utilisateurs. En résumé : on utilise les mêmes outils mais le but est différent. Si votre objectif n’est pas d’améliorer la vie des gens, ce n’est pas de l’UX.

Dans ton livre, “L’UX c’est quoi exactement ?”, tu évoques la notion d’affordance, la capacité d’un objet à exprimer ce à quoi il sert. Comment cela se traduit dans le produit ?
Celia Hodent : L’affordance est effectivement très utile car elle permet de transmettre une information aux utilisateurs sans faire de tutoriel justement. Cela fait appel aux différents sens, pas que le visuel d’ailleurs.
Prenons une porte. Si tu vois une anse, spontanément, tu t’imagines qu’il faut la tirer pour l’ouvrir. On utilise inconsciemment un modèle mental de représentation d’une chose. Une anse sur une tasse, c’est pour la soulever. On a déjà eu ce type d’interaction dans notre vie. S’il faut pousser la porte, alors mieux vaut mettre une plaque : il n’y a pas d’autres interprétations possibles. Si on doit ajouter des tutoriels, comme des panneaux “Pousser”, c’est que l’objet n’est pas suffisamment intuitif.
C’est pareil dans un jeu vidéo. Si tu vois une échelle, tu t’imagines qu’il y a un étage supérieur. Mais s’il s’agit juste d’un élément de décor, alors c’est une “fausse affordance” et cela peut tromper les joueurs. On a souvent à gérer des problèmes de fausses affordances dans les jeux vidéo, notamment dans Fortnite.

Tu peux nous en parler ?
C.H. : On a un pic dans le jeu qui est l’outil unique qui permet de collecter des matériaux, notamment du bois. Il existe aussi une hache qui permet de tuer des zombies. Sauf que dans notre modèle mental, une hache, c’est fait pour couper du bois. Les joueurs se sont alors dit qu’elle serait sûrement plus efficace pour couper du bois… ce que le système ne permet pas !
Pour résoudre ce problème, on a fait en sorte que les joueurs ne trouvent pas la hache trop tôt dans le jeu. Le temps qu’ils comprennent le fonctionnement du pic. On voit qu’il n’est parfois pas obligé de tout refaire pour surmonter ce type de difficulté, mais que c’est tout de même plus efficace et moins coûteux dans le développement d’un produit de repérer ce genre de choses plus tôt.
Dans Super Mario Bros, il paraît qu’on aurait remonté au créateur, Shigeru Miyamoto, que Mario était trop lent. Ce qu’il aurait fait ? Il a juste accéléré l’animation des jambes, sans toucher à la vitesse ! L’illusion a très bien fonctionné. Ce qui compte, c’est la perception, le game feel. C’est-à-dire la sensation que l’on attend.
Tu nous as parlé d’arriver à construire un produit compréhensible et facile d’utilisation. Quelles sont les clés pour qu’il soit aussi engageant ?
C.H. : Il y a plusieurs leviers pour engager ses utilisateurs, qui nécessite de comprendre comment fonctionne la motivation humaine. Il existe deux grands types de motivation :
- La motivation extrinsèque
Elle se fonde sur le système de la récompense : on fait une action pour obtenir quelque chose en récompense. Un niveau supérieur ou un bonus dans un jeu vidéo, une bonne note à l’école, etc…
- La motivation intrinsèque
Elle est liée à l’envie et au plaisir de faire une action. Et ici, on fait appel à trois notions distinctes :
- La compétence : le fait de sentir que l’on progresse dans une activité. Quand on est en échec scolaire, c’est qu’on ne se sent pas compétent. Idem, dans un jeu vidéo, on ne peut pas toujours gagner. Mais le plus important, c’est de faire comprendre aux joueurs pourquoi ils ont perdu afin qu’ils puissent progresser.
- L’autonomie : le fait de pouvoir faire les choses comme on le sent. Autrement dit, qu’il y ait différentes façons d’atteindre un objectif. Cela peut passer dans un jeu vidéo par le choix de la tenue de son personnage ou de la réalisation d’une quête de différentes manières.
- L’affiliation : le fait de se sentir connecté avec d’autres personnes. On va trouver cette notion dans les jeux multi-joueurs ou dans les produits basés sur une communauté.
On a parlé des limites cognitives et des biais des utilisateurs… Mais c’est la même chose pour les concepteurs, non ?
C.H. : Bien sûr ! Nous sommes pétris de biais. Tu vas avoir par exemple le biais endo-groupe : la tendance à favoriser les personnes dont on a l’impression qu’elles font partie de notre groupe. Ce qui se voit dans le recrutement ou dans les promotions. Conséquence : tu te retrouves avec des équipes homogènes qui ne pourront pas avoir de l’empathie pour l’ensemble des utilisateurs. Et ainsi avec des jeux qui ont des nanas dénudées, à la différence des personnages masculins… ce que ces équipes justifient en disant que de toute façon, il n’y a pas de filles qui jouent à ce jeu. Et pour cause !
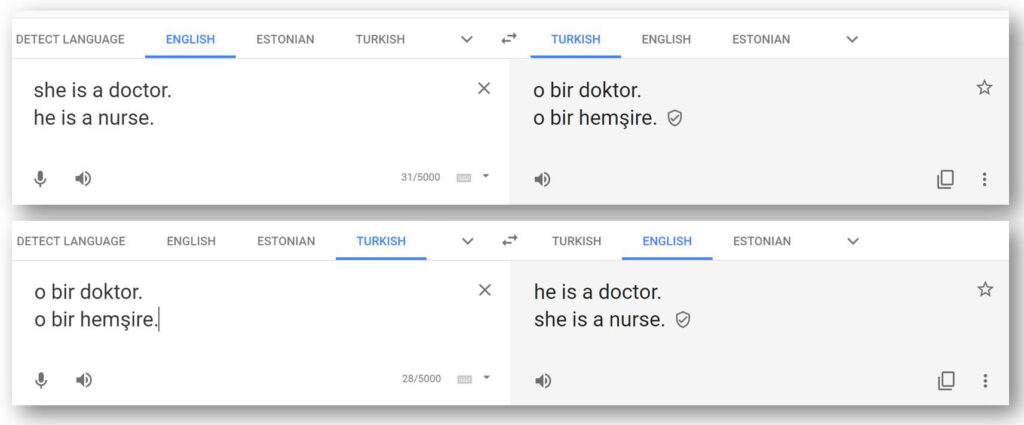
Il y a aussi le biais égocentrique : la tendance à trop faire confiance à notre propre perspective en croyant que les autres ont forcément la même. Le fameux “Je connais mes utilisateurs”.
La façon de s’en débarrasser, c’est de considérer toutes les opinions que l’on peut avoir sur son produit comme des hypothèses… qu’il faudra vérifier avec les utilisateurs ! Mais, là encore, on peut se faire piéger par le biais de confirmation : la tendance à chercher les réponses que l’on attend.
Sans oublier le “biais Ikea” : quand on participe soi-même à un projet, on a toujours l’impression qu’il a plus de valeur. Raison pour laquelle les tests utilisateurs doivent être effectués par des gens qui ne sont pas en train de développer le produit. Et qui sont des spécialistes ! Sous-entendu qui utilisent un vrai protocole de recherche, car il y a énormément de choses qui peuvent influencer les actions et les réponses des participants.
Toi qui connais tous ces biais… Tu arrives à te faire avoir quand même encore ?
Celia Hodent : Et oui, c’est tout le problème des biais : ce n’est pas parce qu’on les connaît qu’on va pouvoir les éviter ! Car ils sont implicites. On ne se rend pas compte qu’on est en train d’agir sous leur effet.
En fait, la seule façon de procéder, c’est de toujours se dire, humblement : je peux me tromper et être biaisé·e. Même si je suis senior ou si j’ai un gros poste. Pas facile car il existe (encore !) un autre biais : la confiance excessive. La tendance à surestimer ses connaissances quand on devient expert d’un sujet. Il faut donc accepter, non pas qu’on peut se tromper… mais qu’on va se tromper ! C’est une certitude.
Pour aller plus loin :
- Les livres de Celia : L’UX, c’est quoi exactement ? (Dunod), Dans le cerveau du Gamer (Dunod), The Psychology of Video Games
- Le portrait de Celia dans Le Monde (solide)
- La conf’ de Celia : “Sciences cognitives et enjeux éthiques en design”
Sur le même thème
Comment l’écosystème produit s’est-il approprié Discovery Discipline ?
Leboncoin, Prestashop, Decathlon... Comment les entreprises appliquent la méthode FOCUSED de Discovery Discipline ?
Rémi Guyot et Tristan Charvillat (Discovery Discipline) : “L’ambition, c’est de faire de FOCUSED…
Un an et demi après la sortie de Discovery Discipline, Tristan Charvillat et Rémi Guyot reviennent sur leurs ambitions pour FOCUSED.
Michael Baeyens : “On a complètement tué la créativité dans les produits !”
Entrevue sans langue de bois avec l’un des cofondateurs de la conf qui tue le game, Michael Baeyens, head of design de France Télévisions, en forme…
Le résumé de Discovery Discipline, la méthode FOCUSED initiée par Rémi Guyot et Tristan Charvillat (Paypal…
Voici les grands principes de Discovery Discipline, une méthode de product management expérimentée chez Paypal et appliquée chez BlaBlaCar
Tristan Charvillat & Rémi Guyot (Discovery Discipline) : « La discovery est un état d’esprit…
Tristan Charvillat et Rémi Guyot (VP Product design et Chief Product Officer de BlaBlaCar) présentent leur méthode Discovery Discipline.
Ce que ton UX writer va te dire au bout de 2 semaines…
Camille Promérat et Amandine Agić, UX Writers et Content Designers racontent l'envers du décor de leur métier... pour les product managers.






